Plongez au cœur de la psychanalyse
Bienvenue sur notre blog. Ici, nous explorons les profondeurs de la psyché humaine à travers des articles rigoureux et éclairants. Découvrez des perspectives uniques sur la psychanalyse, le bien-être et les défis contemporains. Laissez-vous guider vers une meilleure compréhension de vous-même et du monde qui vous entoure. Votre parcours de réflexion commence ici, proposé par Psychanalyste Paris 17.

L'approche psychanalytique en périnatalité
La période périnatale, de la grossesse à la première année de vie de l’enfant, est une étape de bouleversements somatiques, psychiques et relationnels profonds. Si la médecine périnatale assure la sécurité biologique, elle ne suffit pas toujours à contenir les angoisses et les remaniements psychiques que cette phase réactive. L'intégration de la psychanalyse permet de comprendre et de traiter ces affects, fantasmes et angoisses, souvent ignorés par le cadre médical seul.
Le cadre théorique : La psychanalyse considère la parentalité comme un processus de remaniement narcissique et identificatoire majeur. La grossesse, en particulier, réactive les traces mnésiques d’expériences précoces de dépendance et de soin, ainsi que les conflits non résolus liés à la filiation et à la transmission. Il existe un hiatus notable entre la « vérité biologique » du suivi médical et la « réalité psychique » des futurs parents.
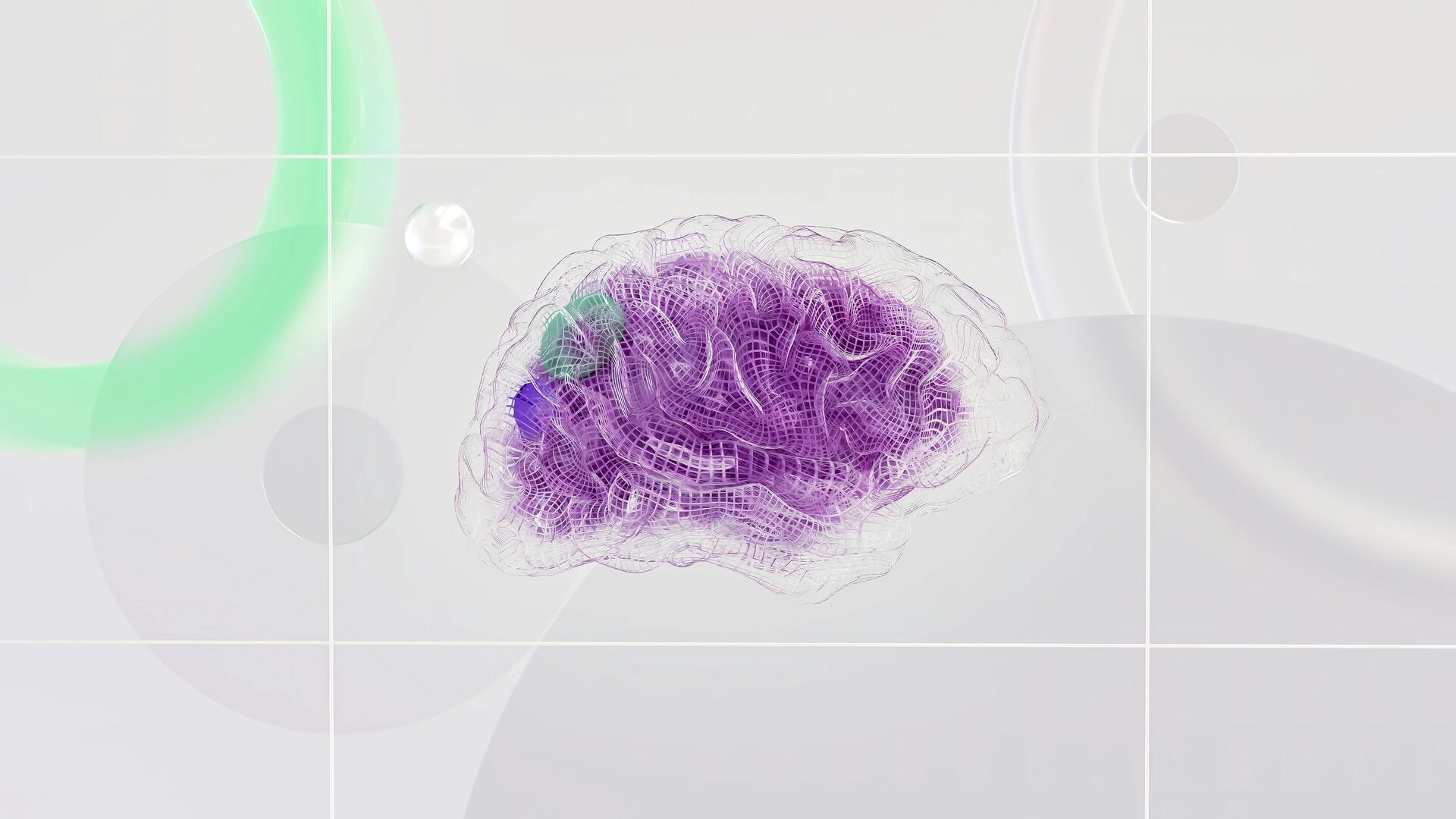
Apports et éclairages en période périnatale
Les apports psychanalytiques en périnatalité sont essentiels : ils permettent la mise en mots des angoisses et l'élaboration de l'ambivalence inhérente au fait de devenir parent (désir et rejet, excitation et peur). Le travail consiste à repérer comment l’infantile du parent se rejoue dans la relation au bébé et comment la fonction contenante parentale va se déployer. Des illustrations cliniques, comme l'ambivalence maternelle après FIV ou le sentiment d'incompétence post-césarienne, démontrent la nécessité de cette articulation.
Conclusion : La période périnatale, marquée par un 'tsunami psychique', illustre avec force la nécessité d'une approche intégrative. L'accompagnement psychanalytique et le suivi médical ne doivent pas être pensés en opposition mais en complémentarité. C'est en travaillant le fantasme inconscient et les identifications que nous contribuons au bien-être psychologique des parents et à la qualité de l'attachement du nourrisson.

Pervers narcissique : une hantise moderne

Jean Racamier, qui a introduit le concept dans les années 80, définit la perversion narcissique comme une structure psychique durable. Elle se caractérise par la capacité d’un individu à fuir ses conflits internes, notamment le deuil, en s’appuyant narcissiquement sur une autre personne. Cette dernière est alors réduite à un simple objet, manipulé et utilisé comme un faire-valoir.
D’un point de vue clinique, l’essentiel à retenir est qu’il n’y a rien à attendre d’une relation avec un pervers narcissique (PN), sinon l’espoir d’en sortir indemne. Ces relations sont destructrices. La notion de PN a pris une telle ampleur dans le discours de certains patients qu’il ne s’agit plus tant de se demander si cette figure existe réellement que de comprendre pourquoi elle fascine autant. Peu importe qu’elle ne corresponde pas à une catégorie médicale stricte : l’enjeu n’est pas de “soigner” le PN, mais bien ses victimes. Peu importe aussi de prouver son existence autrement que par l’ampleur des dégâts qu’il cause. En paraphrasant Feuerbach, on pourrait dire que la femme [1] a créé la perversion narcissique à son image.
Deux concepts freudiens sont au cœur de cette notion : la perversion et le narcissisme.
Freud définit la perversion à travers les déviations sexuelles, qui participent à la construction de la sexualité infantile. Dans ce sens, tout est potentiellement perversion, jusqu’au baiser qui détourne la sexualité de son but reproductif. Toutefois, dans le cadre de la perversion narcissique, ce n’est plus un simple détournement sexuel, mais un véritable mécanisme de défense : une façon compulsive et répétée de manipuler la réalité pour éviter une souffrance interne.
Le PN utilise autrui comme un simple instrument, projetant sur lui ses contradictions internes et ses angoisses insupportables. Il construit ainsi un rempart contre son propre chaos psychique, en rejetant sur l’autre ce qu’il ne peut supporter en lui-même. Plus il recourt à ce mode de fonctionnement, plus il se coupe de tout retour affectif structurant. Ce qui nous différencie d’un PN, ce n’est pas l’absence totale de perversion – nous avons tous recours, à certains moments, à des mécanismes de défense similaires. Mais chez le PN, ce processus devient permanent, rendant toute forme d’empathie inopérante.
Paradoxalement, le PN a besoin des autres, de leur attention et de leur énergie. Mais il instrumentalise tellement ses relations qu’il finit par effacer tout lien humain authentique. Là où un trouble narcissique classique est souvent compensé par une pulsion inverse (culpabilité, besoin de reconnaissance…), chez le PN, cette compensation disparaît. Il colonise la pensée de l’autre, tout en restant hermétique à toute influence extérieure.
Le narcissisme : un miroir déformant
Le narcissisme est essentiel à la construction de l’identité et de la confiance en soi. Mais chez le PN, il se transforme en une quête obsessionnelle d’image et de validation. Ce trouble se manifeste par une survalorisation de soi et une dévalorisation systématique de l’autre – un schéma fréquent chez l’enfant, courant chez l’adolescent, et parfois compensatoire à l’âge adulte.
Dans certaines relations mère-fille, par exemple, on observe un narcissisme destructeur : une mère qui cherche à rester jeune par la chirurgie esthétique peut inconsciemment effacer l’existence symbolique de sa fille. Si la mère est “la jeune”, alors où est la fille ? Elle est soit reléguée au second plan, soit forcée d’adopter un rôle artificiel pour valider l’image maternelle.
Pourquoi ça fonctionne ?
L’objectif ici n’est pas d’analyser ce “néosyndrome” sous un angle médical, mais de comprendre pourquoi tant de personnes tombent sous l’emprise d’un PN. Ce qui surprend, c’est la facilité avec laquelle certaines victimes se laissent enfermer dans ce schéma, parfois jusqu’à une dévalorisation profonde d’elles-mêmes.
Le déni comme moteur
Le mécanisme central du PN est le déni de la castration, au sens psychanalytique du terme. Ce refus d’accepter les limites et la différence des sexes entraîne un clivage profond : socialement, il peut être un individu charmant et irréprochable, mais dans l’intimité, il ne peut jouir qu’à des conditions qui lui sont propres. Si ces conditions entrent en conflit avec les normes sociales, il cherchera à les transgresser. Si elles s’opposent aux désirs de son partenaire, il usera de manipulation et de mauvaise foi.
Ce clivage rend son emprise redoutable. Comment dénoncer un homme qui, en apparence, est irréprochable ? La victime se retrouve isolée, prisonnière d’un paradoxe qui la fait douter d’elle-même.
La perversion et le féminin
Freud observe que le pervers reste figé à un stade où la différenciation sexuelle n’est pas encore pleinement intégrée. Il entretient donc une porosité entre masculin et féminin. Certains PN, par exemple, recherchent des femmes mariées pour mettre en scène, inconsciemment, une homosexualité latente, où le mari joue un rôle à son insu.
De façon plus générale, ce que la victime perçoit et aime chez le PN, c’est souvent son versant féminin refoulé. Il incarne, de manière ambivalente, une part du féminin qu’elle cherche elle-même à appréhender. Ce lien imaginaire la retient prisonnière : le quitter reviendrait à renoncer à une partie d’elle-même.
Une manipulation absolue
Le PN manipule avec un talent redoutable. Il consacre toute son intelligence à cet art, sachant dire exactement ce que sa victime veut entendre. Mais son atout principal, c’est qu’il n’aime personne, pas même lui-même. Il a franchi un tabou : il sait dire “je t’aime” sans jamais aimer. Cette capacité à simuler l’amour sans l’éprouver lui confère une aura quasi mystique. La victime reste, persuadée que l’amour finira par venir, que tout cela fait partie du jeu.
Une douleur entretenue
Le PN ne se contente pas de priver sa victime de sa subjectivité, il la fait souffrir tout en lui donnant l’illusion de vivre intensément. Il caresse ses doutes, amplifie ses insécurités, l’encourage dans sa culpabilité. Certaines victimes, habituées à cette mécanique, finissent par ne plus ressentir d’émotions en dehors de cette dynamique. Le PN leur donne l’impression d’exister, alors que lui-même ne cherche qu’à survivre à son propre vide intérieur. Il promène son caddie dans un Intermarché vide, mais il n’est pas seul.
La perversion est un piège
Le PN sait choisir ses proies. Il repère les failles narcissiques et les comble par des promesses d’amour et d’admiration. Il cible les personnes en proie à la culpabilité ou à la peur de l’abandon, les enfermant progressivement dans une relation où elles perdent toute autonomie.
Sortir de l’emprise d’un PN est un long chemin. Certaines femmes, après avoir réussi à quitter un PN, en retrouvent un autre, comme si elles répétaient inconsciemment le schéma. Pourtant, cette libération est essentielle : elle marque une forme d’émancipation, une prise de conscience qui peut être fondatrice.
Se détacher d’un PN, c’est reconquérir sa liberté. Car au fond, le PN ne sert à rien… sauf si l’on continue à s’en servir.
CONCLUSION :
La perversion narcissique est ambivalente; elle provoque à la fois attirance et répulsion. Chaque relation de PN peut enclencher une série de mécanismes pervers, où la victime est infantilisée et piégée dans un cycle d’auto-dénigrement. Le pervers choisit ses victimes avec soin, ciblant les failles narcissiques pour mieux les manipuler. S’affranchir d’un pervers narcissique est un long et complexe processus de guérison, souvent perçu comme une odyssée personnelle. Ce chemin vers la liberté nécessite une prise de conscience profonde, permettant de reconstruire une identité saine et émancipée. Néanmoins, il est essentiel de comprendre que la perversion narcissique ne sert à rien et constitue un obstacle à la réalisation de soi. En résumé, la perversion narcissique est un combat de plein fouet contre des mécanismes psychologiques profondément ancrés. La connaissance et la reconnaissance sont les premières étapes vers la guérison des blessures infligées par cette dynamique toxique.

Un psychanalyste woke ça n’existe pas
Neutre autant que faire se peut
Tout s’inaugure ainsi. Tout s’ouvre par l’instinct qui poursuit la jouissance, par ce souffle premier qui précède la pensée et embrase le corps. Tout commence dans la chair, dans cette pulsion souveraine qui exulte d’être incarnée, qui s’émerveille de voir, d’entendre, de sentir, de vivre. Le plaisir immense d’être, la jouissance pure des sens, la peau frémissante au contact du monde, la volupté secrète des orifices, le vertige joyeux de l’existence qui s’offre en totalité. Tout commence dans cette extase première, dans ce frémissement vivant qui appelle le monde à soi et soi au monde.
Cette jouissance primordiale se transplante dans l’inconscient pour s’y réfugier et pour y être déchiffrée. Et puisqu’elle ne peut être totale, elle exige de s’exprimer, dans l’espoir que, dans le discours, au sein de l’entrelacs des signifiants et de l’océan des signifiés, émerge un reste qu’elle espère identifiable et saisissable sauf à signer sa propre disparition. Ce reste, le psychanalyste le désigne comme l’objet a.
Nous sommes faits de la même étoffe que nos rêves, et notre petite vie est entourée de nuits mystérieuses. — La Tempête Shakespeare
La jouissance connait un itinéraire. Son parcours la mène dans un au‑delà d’un inconscient à l’œuvre, occupé au geste ininterrompu de la parole et de son infatigable interprétation. Il s’agira en séance de dire, et d’entendre. Viendront des fragments de fantasmes, des retours du refoulé. Dans son extraterritorialité, la psychanalyse en son foyer ne va pas plus loin. Le trajet s’arrête à la seconde où l’inconscient malicieux prend la parole, lui qui n’a pas d’autres choix. L’inconscient, plus grande partie du moi, se situe en deçà et hors des stratifications du bruit verbeux, militant ou pas ; il ignore les lointaines querelles occupées au religieux, à la philosophie, à la littéraire. Il a sa propre poésie, celle du sujet lui-même qui parfois émerge. Aussi, pour aiguiser son écoute, le psychanalyste doit être aussi neutre que possible, et s’il reste une personne avec ses propres valeurs, en séance, la seule valeur qui doit faire magistère, celle la plus centrale et essentielle : une écoute pleine, donc innocente et flottante. Il se refuse à militer en faveur d’aucune religion, doctrine ou philosophie. Il sera attentif aux effets du racisme, du sexisme, de la transphobie ou de l’homophobie sur la subjectivité de ses patients. Mais sans point de vue. Il ne peut être woke sauf à cesser d’être psychanalyste.
Une symphonie désaccordée
La psychanalyse n’est soluble dans rien. Elle se refuse aux adjectifs : il n’existe pas de psychanalyse occidentale, orientale, chinoise, blanche, noire, juive ou chrétienne. De la jouissance originaire jusqu’à l’objet petit a, son trajet est complet et total. Au-delà, elle disparaît. Certains ont voulu penser la psychanalyse à travers la philosophie. C’est une illusion, semblable à celle de l’homme qui cherche ses clés sous un lampadaire la nuit, non parce qu’il les y a perdues, mais simplement parce que c’est le seul endroit où il peut voir. Le philosophe, penché sous sa lumière, refuse d’affronter son intime et son équivoque. Il croit esquiver sa limite. Il imagine croire à sa science, mais en vérité il ne fait que croire qu’il pense. Marier la philosophie avec la psychanalyse, c’est divorcer d’elle. On n’est pas psychanalyste par mariage!
De même, ceux qui veulent mêler psychanalyse et doctrine woke ne saisissent pas mieux ce qu’est la psychanalyse. Le wokisme décrit le monde, à la manière d’un sociologue. Mais le sociologue reste impuissant à comprendre ce qui se joue, ou ce qui échoue, dans un cabinet de psychanalyse. Il croit voir du collectif dans l’individuel, et de l’individuel dans le collectif, mais il ne fait que tourner autour de son lampadaire.
« Quelle époque terrible que celle où des imbéciles gouvernent des aveugles. »
— William Shakespeare, Jules César
Il lui échappe que la cure recèle un mystère d’une autre nature. Quand les concepts, y compris les siens, se retirent, la psychanalyse rencontre l’anti-réel le plus radical : l’amour. S’absenter de l’amour, c’est condamner à ne produire que du symptôme.
La lente lecture du sujet par le psychanalyste se détourne, consternée, de l’idée d’inspiration woke, selon laquelle les oppressions systémiques laisseraient des marques psychiques profondes. Le trauma, pour l’analyste, ne raconte sa nature qu’au miroir du symbolique, transmué par l’inconscient. C’est là, sur la scène intérieure inconsciente de l’analysant, dans les méandres de son histoire psychique et dans les replis inachevés du refoulement, que se livre son intime secret. Les traumatismes collectifs ne sont que vacarme. Sur le divan, le vocabulaire peut être woke ; mais la grammaire, elle, reste a-woke. Le politique qui cherche à collectiviser le trauma ne fait qu’ignorer l’inconscient et sa singularité. Et si la rue gronde, le psychanalyste, lui, se lèvera pour refermer les fenêtres.
L’ère des bons sentiments
Née à la fin du XIXᵉ siècle, la psychanalyse s’est d’abord attachée aux névroses, l’hystérie en étant le modèle inaugural. Freud a montré que chacun est travaillé par une mémoire inconsciente qui le détermine malgré lui. La névrose naît du conflit entre désirs singuliers et règles sociales, intériorisées sous forme de surmoi, générant culpabilité et angoisse. La cure consiste à libérer les possibilités de jouissance prisonnières du duel Ca/Surmoi — et l’analyste n’a pour arme que la parole.
Ce modèle s’inscrivait dans une Europe puritaine, saturée d’interdits moraux et religieux. Au XXᵉ siècle, la chute des cadres collectifs et l’essor de l’individualisme ont déplacé la dynamique : d’une logique centrée sur le surmoi (les intérêts communs) vers l’idéal du moi (narcissisme et liberté individuelle). Désormais, le psychisme se déploie en agora TikTok : vaste, fuyante, impersonnelle, kaléidoscope sans ancrage. Le vernaculaire s’évapore. Et moi, et moi, et moi !?
Depuis les années 1980, une partie de la communauté psychanalytique internationale a infléchi son orientation. Aux États-Unis surtout, certains praticiens ont peu à peu abandonné la règle classique de neutralité — qui exigeait de l’analyste qu’il se réserve et se retire, sans expression de jugement ni d’affect. Ils lui ont préféré une posture d’écoute empathique, cherchant à pénétrer le vécu du patient, à lui témoigner reconnaissance et chaleur. Séduisant maternage, mais délétère. Et d’une redoutable paresse ; l’analyste y flatte son narcissisme de soignant, tandis que l’analysant se croit compris. Pendant ce temps, l’inconscient demeure seul, à la porte du cabinet, attendant le geste analytique qui donnera une fin à la cure. Mais dans cet univers aliénant d’empathie, cette fin n’advient jamais. Quant à la cure a t-elle seulement commencé ?
Cette évolution s’est traduite par un déplacement des priorités : l’expression immédiate des émotions l’emporte désormais sur la recherche minutieuse des souvenirs refoulés. Le symptôme prime. Plutôt que de reconstruire le passé comme une vérité enfouie à déchiffrer, on façonne avec le patient un récit de soi, destiné à lui offrir reconnaissance et cohérence. L’objectif n’est plus de le confronter aux zones obscures, inquiétantes ou moralement ambiguës de son inconscient, mais de lui proposer un espace sûr, où son vécu peut être accueilli, partagé et intégré dans une histoire rassurante et porteuse de sens. Ici, l’effet du discours précède le discours lui-même.
Nouveau paradigme
L’un des enjeux de cette nouvelle conception du psychisme réside dans le rejet des différenciations qui structuraient autrefois la vie intérieure, dorénavant perçues comme des entraves à la toute-puissance du moi. L’horizontalité factice remplace la verticalité performante.
En psychanalyse, le complexe d’Œdipe met en scène une situation triangulaire où l’enfant, le père et la mère s’entrelacent dans un réseau de désirs, de rivalités et d’identifications. Il ne s’agit pas seulement d’une étape développementale, mais d’une grille de lecture précieuse pour penser l’absence, la limite et la différence. Cette matrice repose d’abord sur la distinction des sexes, qui oppose les figures parentales et nourrit les identifications masculines et féminines. C’est la « mauvaise nouvelle » de Freud : tout procède de l’identification. La même matrice implique aussi la différence des générations, qui sépare l’enfant de ses parents et le protège de ses désirs les plus interdits — l’inceste ou le parricide.
Dans l’idéologie postmoderne, toute différence est vécue comme une violence. La distinction des sexes est dénoncée comme une assignation artificielle et oppressive, simple effet d’un système de domination. De même, la différence des générations est contestée : l’inégalité entre parents et enfants est assimilée à de la tyrannie, l’autorité à de l’autoritarisme. Dans cette logique, toute hiérarchie devient suspecte et l’on érige l’horizontalité intégrale en norme, où chacun doit être l’égal de tous.
Cette égalité absolue, décrétée depuis un « haut lieu » introuvable, s’impose comme un impératif. Mais elle laisse l’individu plus seul que jamais, enfermé dans une position de toute-puissance (où il croit fabriquer son haut lieu) sans repères ni limites, privé de ce qui pouvait le protéger de la violence de ses désirs infantiles. À la clé : une vulnérabilité accrue à la souffrance psychique et aux dérives destructrices.
Le surmoi ne se présente plus comme la voix d’un tiers, porteur d’un ordre supérieur extérieur — religieux, symbolique ou institutionnel. Il se fait désormais entendre comme l’exigence intime d’une identité personnelle. L’autorité morale ne parle plus « d’en haut », mais « de l’intérieur », et non plus au nom d’un idéal universel, mais au nom de soi.
Dans cette logique errante, le wokisme devient une inquisition moderne, substituant Dieu à l’idéal du moi : le blasphème se transforme en offense, le péché en violence symbolique, et le bûcher cède la place à l’« annulation » publique. Le moteur n’est plus la culpabilité — sentiment né du conflit entre le désir (Ça) et l’interdit (surmoi), qui jadis guidait le renoncement et traversait la castration, exercice fondamental de la cure — mais la honte, émotion plus intime et sourde, née de l’écart douloureux entre l’image que l’on se fait de soi et l’idéal d’un moi que l’on voudrait incarner.
Cette honte est lourde d’enjeux existentiels : elle révèle des fragilités profondes, une instabilité de l’estime de soi, parfois une haine de soi qui s’accompagne d’une angoisse dépressive. Pour y remédier, le sujet postmoderne proclame sa toute-puissance, revendique l’absence totale de limites. Le conflit intérieur n’est plus géré dans le secret du psychisme, entre différentes instances de la personnalité. Il est projeté vers l’extérieur : l’ennemi n’est plus en soi, mais chez l’autre, chez ce double, ce même, ce miroir ou ce contraire, accusé d’imposer des frontières qui entravent la pleine jouissance de soi. Cette projection de type paranoïaque ne s’intéresse pas à soulager un nœud névrotique ; elle charge un autre de dire qui l’on est. Et de le valider au péril de n’être rien, d’où la ferveur agressive du discours, de la vitupération autant que de son exigence revendicatrice. Dis-moi ce que tu vois en moi et t’as intérêt à bien répondre !
C’est de cette inversion que naît la posture identitaire et victimaire propre au wokisme : il ne s’agit plus de composer avec la frustration ou de négocier avec l’interdit, mais d’affirmer son identité, de la brandir comme une vérité intangible, et de dénoncer comme une agression toute remise en question de cette identité . Le sujet postmoderne ne s’enferme plus dans l’inhibition névrotique ; il se déploie au contraire dans une affirmation constante de soi, traquant tout ce qui pourrait en freiner le triomphe.
Parallèlement, cette morale ne balaie pas devant elle. L’hyper-moralisation contemporaine pousse à écarter tout ce que la vie psychique peut contenir de dérangeant ou d’immoral, au profit d’objectifs (ré)éducatifs. Or, quand il réfléchit aux enjeux éthiques de la psychanalyse, Freud insiste sur un point : elle ne doit jamais devenir une leçon de morale adressée au patient. Il met en garde contre la tentation de « modeler à notre image » la personnalité de celui-ci ou de lui « inculquer nos idéaux ». En clair, l’exigence éthique première pour le clinicien est de ne pas utiliser l’influence que lui confère sa position dans la relation thérapeutique pour chercher à remodeler le patient selon ses propres convictions. Il ne répond pas à la question qui suis-je. Il ne valide aucune réponse. Il sait que tout n’est qu’identification ; il sait aussi que la vérité du sujet ne s’écrit pas dans le marbre, fut-ce celui d’un piédestal. L’âme est plastique.
La fausse gloire de l’empathie
Et pourtant, l’air du temps soutenu par la gloriole de la bonne conduite autour de l’empathie a engendré une créature étrange. Ces dernières années, on a vu apparaître ce que certains appellent des « psychologues situés » : des praticiens qui se présentent comme « safe et inclusifs » et publient la liste des « oppressions systémiques » qu’ils s’engagent à accueillir avec bienveillance — laissant ainsi entendre que les autres thérapeutes seraient, au mieux, indifférents, au pire, hostiles. On y trouve pêle-mêle les publics LGBTQIA+, racisés, polyamoureux, travailleuses du sexe, neuro-atypiques, victimes de grossophobie, de validisme, d’âgisme, et bien d’autres. Doit-on rappeler à ces praticiens abhorrant Freud que la formidable et marquante révolution des esprits, qui devait voir émerger les gender theorys, doit tout à la découverte en 1905 par Freud de la bisexualité psychique. Dès l’enfance, la sexualité n’est pas strictement hétérosexuelle ou homosexuelle, mais plutôt une structure dans laquelle les tendances peuvent se balancer ou coexister.
Selon Freud, l’organisation de la libido ne se limite pas à une seule orientation, mais implique une bisexualité inhérente à la nature humaine. Cela signifie que chaque individu possède en lui des tendances ou des potentialités pour l’attirance vers des partenaires de différents sexes, une bisexualité psychique qui influence la formation de l’identité sexuelle et les développements psychiques. Trois essais sur la théorie de la sexualité Paris : PUF, 1976 (version originale : Three Essays on the Theory of Sexuality, 1905).
Ces psychologues ne mettent pas en avant une expertise acquise par la formation ou par l’expérience mais un engagement militant présenté comme garant d’empathie (encore cette affreuse empathie !) et de prédisposition. Leur promesse au patient : rencontrer une sorte de miroir, un semblable rassurant, porteur d’une fascination spéculaire et d’une bienveillance censée, à elle seule, avoir un effet thérapeutique. Cette approche, résolument identitaire, mixe volontairement pratique clinique et engagement idéologique. Elle rompt avec les principes déontologiques fondamentaux qui exigent du psychologue une distance, une neutralité et une ouverture à toute personne, indépendamment de ses appartenances ou revendications. L’accueil du patient se réduit à un guichet où l’on immatricule son identité, comme si son existence se confondait avec un simple code administratif.
La fascination de la singularité
Ce qui donne toute sa force à l’approche clinique d’un psychanalyste, c’est une foi profonde en l’humanité, dans ce qu’elle a d’universelle et d’infiniment singulière. Personne n’est réduit à un genre, une orientation sexuelle, un âge, un milieu, une origine. Personne n’est enfermé dans un diagnostic, un comportement, un symptôme, ni figé dans le rôle de victime ou de coupable. Chaque personne est entendue comme une histoire unique, riche d’ombres et de lumières, irréductible à toute étiquette. Dans le cabinet du clinicien, le trait qui inquiète ou fascine — qu’il soit pointé par le patient, la famille, l’école, la médecine ou la justice — retrouve sa juste place : celle d’un élément parmi d’autres, inscrit dans une trame plus vaste, tissée de souvenirs, de liens, de contextes sociaux et culturels en perpétuel mouvement.
Être freudien suppose de prendre au sérieux l’inconscient, les pulsions et les conflits psychiques, ainsi qu’une vision relativement universelle de la psyché humaine. Être woke, dans le sens militant et critique contemporain, implique une attention aux rapports de pouvoir, aux discriminations systémiques, aux identités sociales et à la manière dont le langage et la culture façonnent l’expérience. C’est une grille de lecture centrée sur la justice sociale, les oppressions et le communautarisme des vécus. Freud considérait la subjectivité comme partiellement indépendante des identités sociales, alors que l’approche woke place ces identités au centre de l’expérience.
Bricoler
Le psychanalyste ne doit jamais imposer sa vision politique en séance. Il n’a nul besoin d’être « woke » pour prendre en compte les effets du racisme, du sexisme, de la transphobie ou de l’homophobie sur la subjectivité de ses patients. Il intégrera l’idée que les oppressions systémiques laissent des traces psychiques, tout en continuant de débusquer, derrière le dire de l’analysant, la scène du fantasme, toujours apolitique.
Au fond, le psychanalyste travaille comme un artisan : il bricole, actualise Freud et déchiffre les frictions entre un langage hérité du début du XXᵉ siècle et une sensibilité politique du XXIᵉ. La posture analytique repose sur le transfert et la neutralité bienveillante. Toute militance brouille l’écoute.
Au fond, un « psychanalyste woke » ca n’existe pas.